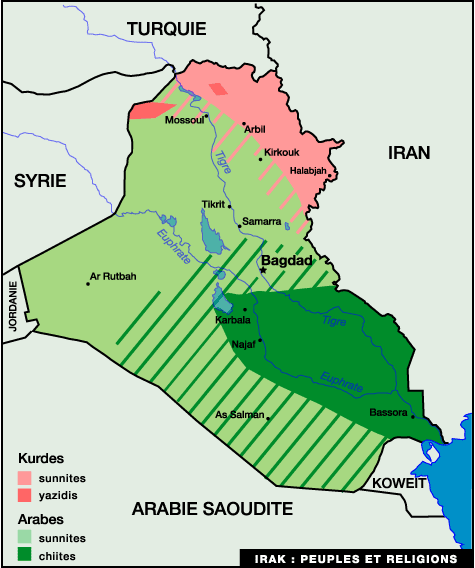Ô magnifiques seins, vénustés incomparables qui m’attirez ici tant de visiteurs... Je savais, en effet, qu’en plaçant « seins nus » dans les titres de mes deux premiers articles j’allais forcément attirer un peu de monde. Je ne savais cependant que j’allais en pêcher dans mes filets (les rets d’Aphrodite ?) autant.
Ô magnifiques seins, vénustés incomparables qui m’attirez ici tant de visiteurs... Je savais, en effet, qu’en plaçant « seins nus » dans les titres de mes deux premiers articles j’allais forcément attirer un peu de monde. Je ne savais cependant que j’allais en pêcher dans mes filets (les rets d’Aphrodite ?) autant.Puisque cela fonctionne, et qu’il n’y a là en vérité nulle malice pourquoi ne pas augmenter mes chances avec les moteurs de recherche ? Et avec les gens patients, car, franchement, pour atterrir sur ce blog en tapant « seins nus » dans un moteur de recherche, il faut être un véritable passionné du terme...
Voilà qui me rappelle, d’ailleurs, un temps antique où, pour l’amusement, j’avais (excusez du langage peu châtié qui va suivre) inscrit « gros seins » sur un moteur de recherche. Devinez donc quel fut le premier lien que fournit ledit moteur de recherche ? Allez, un peu d’imagination. Soyez créatifs... Non, franchement, vous ne voyez pas ? Simple, pourtant, le moteur de recherche, bien futé et farceur, nous renvoya en premier lien : Promoviande, spécialiste de la viande en gros. Authentique... Avec mon frère, nous en rions encore.
Mais, somme toute, au-delà de l’intéressant symbole sur la triste consommation de la chair, ce moteur ne se souvenait-il point du temps jadis, où l’on sacrifiait à Aphrodite ? Eh oui, à la déesse de l’amour, de la beauté, mais surtout de la fécondité et de la fertilité, on sacrifiait de doux animaux. Mon Commelin, qui confond systématiquement dieux grecs et romains (c’en est énervant), m’apprend qu’à Aphrodite, et donc ensuite Vénus, on sacrifiait le bouc, le verrat ou le lièvre. À quelle Aphrodite ou Vénus cependant ? Car elle est multiple, l’Aphrodite grecque, qui est certes la déesse de la fertilité et de la fécondité, la déesse de l’amour et du désir (rôle plus spécifiquement dévolu à Éros), mais est aussi Ourania, déesse céleste, Pélagia, déesse marine, et souvent Poliade, divinité de la cité, comme à Sparte, ou à Corinthe, où elle possédait de nombreux temples, dont ceux de l’Acrocorinthe (la « Corinthe haute », autrement dit l’acropole), où elle est armée (comme à Sparte), et de l’Aphrodite Mélaina hors-les-murs. Mélaina, car « noire », cette Aphrodite la Noire étant, bien sûr, une variation de Déméter, une déesse de la terre sombre, des richesses que détient Ploutos, dieu du sol et des ses profondeurs, avant de devenir dieu des enfers sous le nom de Pluton, chez les Romains. Et un trait antique qui nous explique donc pourquoi, aujourd’hui encore, des « Incas » (des Quechuas, plus probablement) christianisés, et devenus catholiques, persistent à accomplir un sacrifice au Diable, en creusant un trou dans la terre où ils jettent quelques offrandes. L’Église ne leur a-t-elle point appris, parmi ses mythes, que le Diable est maître des Enfers, autrement dit des profondeurs de la terre ? Et ne savent-ils pas, dans leur « sagesse » païenne, que c’est cette même terre qu’il convient de se concilier pour obtenir de bonnes récoltes ?
Aphrodite la Noire, parèdre du Diable ? Après tout, l’étoile Vénus, ne portait-elle point le nom d’Hespéros (celle du soir) ou Phosphoros (celle qui porte la lumière) chez les Grecs, noms qui se transcrivaient Vesper et Lucifer chez les Romains ? Mais, à cette haute époque, Lucifer n’était point le diable, n’en déplaise au sens que prit ce nom. Faire du « Porte-Lumière » un avatar de Satan présente d’ailleurs une étrange image de la religion qui fit, ainsi, ce parallèle, si l’on y réfléchit bien.
Nous voici donc bien loin des vénustés complaisamment étalées, des gros seins sacrifiés à Aphrodite par Promoviande, des seins lourds de la littérature, et autres appas proéminents, poitrines généreuses, volumineuses ou opulentes, tant de synonymes pour désigner la même chose : deux mamelons de robuste taille. Bien qu’en vérité, certainement, ceux-là même qui ont confondu, complaisamment, Lucifer et le Diable, vous rétorqueraient qu’à ainsi lister les vénustés féminines nous n’en sommes que les tristes suppôts. Tremblez donc...
Il était donc néanmoins, un temps, où ni en Grèce, ni à Rome, Lucifer ou Vesper, Phosphoros ou Hespéros, n’étaient l’étoile Vénus, car ni les Grecs, ni les Romains ne nommaient ainsi l’étoile du matin ou du soir (et dont ils mirent un certain temps avant de comprendre qu’il s’agissait de la même étoile). C’est par Corinthe que nous pouvons comprendre comment se fit cette transformation. Corinthe, l’orientalisée, où l’on adorait Aphrodite, une Aphrodite, en vérité, très orientale. Non l’Aphrodite Noire, qui pourrait nous rappeler l’Isis Noire, mère d’Harsiesis (Horus fils d’Isis), car tel était, sur les rives du Nil, le nom de l’étoile Vénus. Mais l’Aphrodite de la cité, à qui étaient dévouées un corps de mille prostituées sacrées, dénommées hiérodules (esclaves sacrées), qui rappelaient fortement les prostituées sacrées d’Ishtar à Babylone. Ishtar, maîtresse du ciel, qui aux yeux des Babyloniens brillait dans le ciel de l’éclat de cette étoile que nous dénommons toujours Vénus, et que nous savons planète. Ishtar, qui transita jusqu’aux rives de la Méditerranée par les traits d’Astarté, la déesse phénicienne, maîtresse du ciel, et face de Baal (du Seigneur, voilà qui rappelle d’ailleurs la douce médiation de la Vierge, à qui l’on s’adresse plutôt qu’à Dieu lui-même, trop effrayant pour l’humble croyant). À Chypre, île par excellence d’Aphrodite, colonisée en partie par les Phéniciens, et à Corinthe, ville commerçante en relation directe avec la Phénicie, l’on adora donc une Astarté qui portait un nom grec : Aphrodite. Et ainsi donc naquit cette Aphrodite Ourania, du ciel, et cette Aphrodite Pélagia, protectrice de ces marins qui commerçaient originellement avec le Levant, et qui n’était autre qu’une Astarté hellénisée.
Une déesse donc point différente de l’Isis gréco-romaine, entre autres protectrice de la navigation, et qui devait, on le sait, paver la voie par son culte, à celui de la Vierge. Où l’on retrouve donc la Grande Mère, sous l’un de ses multiples avatars.
Cette Grande Mère dont les servants cherchaient à trouver les signes terrestres via, souvent, des mamelons proéminents s’élevant du sol de la terre mère... Et ainsi la boucle est bouclée.